
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
La médaille de baptême



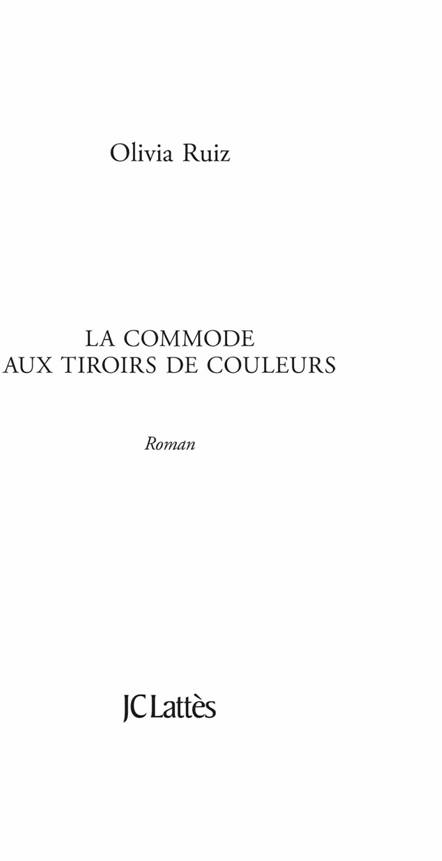
À mes parents, mon frè re et toute ma famille.
À Nino.
Se taire et brû ler de l’inté rieur est la pire des punitions qu’on puisse s’infliger.
Federico Garcí a Lorca
Le dé racinement pour l’ê tre humain est une frustration qui d’une maniè re ou d’une autre modifie la clarté de son â me.
Pablo Neruda
Prologue
On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec Papi, §a nous a fait du bien. Ma fille Nina s’est ré veillé e et s’y est mise aussi. On avait dé jà ré ussi à lui refiler le virus. Je n’avais pas envie de laisser Papi ce midi. Il n’a plus rien, lui, maintenant que ma grand- mè re est partie.
J’arrive à pied en haut de la Butte, haletante, mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l’autre. É puisé e par mon chagrin, j’ai soudain la sensation d’ê tre ma grand-mè re quatre-vingts ans plus tô t, gravissant les Pyré né es. Grelottante. Perdue. Amputé e. Elle de sa terre. Moi de sa pré sence dé sormais.
Tant de gens sont venus saluer sa mé moire, ni mon grand-pè re ni moi ne connaissions la moitié de l’assistance. Elle a dû en emporter des secrets dans sa tombe, la canaille… Nous nous sommes sentis plus fiers encore d’avoir occupé les deux premiè res places dans son cœ ur.
J’ai mal aux jambes. Le Sacré -Cœ ur semble encore avoir pris un ou deux é tages, comme les soirs où je rentre trop saoule. Je m’arrê te. Plus que six mè tres. Plus qu’à s’y mettre, comme disait l’Abuela.
J’ouvre la porte de mon appartement, allume la lumiè re, et elle est là. La commode. Chez moi. Au milieu du salon. Et de la cuisine d’ailleurs. Elle sera resté e magique mê me aprè s son dé part, ma grand-mè re. Cette pensé e me fait sourire. Et pleurer. Puis ré aliser. Que vais-je faire de cette foutue commode? Trente mè tres carré s, c’est confortable pour Nina et
moi. Mais trente mè tres carré s à partager avec la commode, §a va devenir compliqué.
Quand l’é nigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mè re, j’avais quatre ans. Cet é vé nement est si frais dans ma tê te que j’ai l’impression qu’il date d’il y a moins d’une heure. Avec mes cousins, on s’est enfié vré s mille fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attiré s comme des aimants à bê tises par l’arc- en-ciel de tiroirs, les petites clefs sur chacun d’eux qui suppliaient d’ê tre tourné es, le mé tal doré qui renfor§ait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore. Mais à chaque fois notre mamie a poussé un de ces cris suraigus radicalement dissuasifs dont elle seule avait le secret. Et nous, nous avons pris la poudre d’escampette en moins de temps qu’il n’en faut pour cligner des yeux. Ces essais loupé s finissaient souvent par de grands conciliabules familiaux durant lesquels notre jeune gé né ration imaginait une mamiethologie invraisemblable.
— Et si le tiroir jaune contenait une photo de moi et de ma sœ ur siamoise, qui, elle, serait morte le jour de l’opé ration pour nous sé parer? Ç a expliquerait ma cicatrice sur le crâ ne…
Mon petit cousin Maxime avait sa thé orie sur le tiroir bleu:
— Je crois que le secret que l’Abuela cache là -dedans, c’est que je suis le frè re de notre cousin Yannick. Ç a me travaille. Je lui ressemble beaucoup plus qu’à toi. Comme Maman a eu des complications le jour de ta naissance, elle a dû devenir sté rile et on m’a offert à elle pour la consoler.
Mais nos questions sur la commode demeuraient sans ré ponses. Enfant, je jouais de ma position de favorite pour que l’Abuela me dé voile le pré cieux tré sor. Elle m’appelait si fiè rement « mon tournesol ». Mais rien n’y faisait. Ma grand-mè re, depuis toujours, c’est elle qui dé cide, elle qui nous mate. Elle est comme sa cuisine, d’abord elle te tente irré sistiblement, te surprend, puis te violente de son tempé rament é picé. Quand le repas est terminé pourtant, c’est une saveur suave qui te reste dans la bouche, rassurante parce qu’elle te donne l’impression d’ê tre aimé passionné ment.
J’ai tellement attendu ce moment que je risque de mourir aprè s l’avoir vé cu. Enfin, aprè s tant d’anné es d’impatience dompté e, je vais savoir pourquoi elle s’emballait à ce point pour cacher le secret que renfermaient ces dix tiroirs. Ma grand-mè re les nommait ses renferme- mé moire.
J’ai couché ma fille. Elle lui ressemble tellement. J’espè re que je serai une aussi bonne maman qu’elle le fut pour moi. J’ai mis un vinyle d’Ennio Morricone. Abuela. Personne ne l’a jamais appelé e autrement. Avec ses yeux noirs et sa peau tanné e, §a lui allait bien l’Abuela. Il Padrino. L’Abuela. Dans ma famille, de toute fa§on, de mè re en fille on appelle sa grand-mè re « Abuela ».
Pour aller me faire un thé, je suis passé e devant la commode. Les larmes et le sourire se sont brutalement invité s sur mon visage, comme deux convives mal assortis. Sentant le moment au bout de ma main, j’ai huit ans et une palette d’é motions allant de l’envie fié vreuse à la conscience dé jà nostalgique qu’une grande page va se tourner. Ç a pé tarade en moi comme le moteur d’une Harley. Je me reprends. C’est vraiment tout ce qu’elle dé teste, la sensiblerie. Je ne l’ai jamais vue pleurer, et je savais qu’elle m’aimait forte, indé boulonnable, comme elle. Ce que j’é tais. Presque. Ce que j’aurais aimé ê tre.
Dans cette famille, nous parlions beaucoup, à pleine voix, et surtout pour ne rien se dire. La seule fois où elle a ré agi à un de mes je t’aime, elle a ré pondu: « Nous aussi on t’aime bien. » Je n’ai jamais cessé de le lui dire pour autant. J’ai mê me fini par aimer §a, le dire à sens unique. À chaque seconde son amour pour moi transpirait par tous ses pores. Pas besoin de mots. Ni de gestes tendres. Ou alors elle les offrait au chien, qu’elle caressait en me regardant. Lui, il me les rendait volontiers dans la foulé e, ces câ lins.
L’é norme commode en chê ne massif abrite dix tiroirs. Trois rangé es de trois, pas parfaitement aligné s, et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l’interdit n’a pas diminué avec les anné es, j’ai l’impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je guette le dixiè me tiroir, le plus petit, celui qui n’a rien à faire là. Le plus mysté rieux.
Ma main perd ses moyens, s’agrippe à sa clef. J’ai le vertige de savoir ce que je vais dé couvrir. Je l’ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit dé finitivement levé.
Ce tiroir est bien rempli, je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaronis au cendrier en pâ te à sel, mes plus grandes œ uvres s’y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j’ai confectionné pour elle. Un festival d’horreurs conservé tels des tré sors. Les souvenirs resurgissent. Je m’é loigne et fais les cent pas. Comme si je n’é tais pas encore prê te à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-ê tre assez pour le moment.
J’en sors une photo de mes cousins et moi devant le mobile home que louaient Papi et l’Abuela chaque é té au camping de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui é mane de nos visages rafraî chissent le papier dé lavé. Nous é tions heureux. Dormir tê te-bê che à six dans le lit des grands-parents, avec eux bien sû r, ne nous posait aucun problè me. Au contraire, quand l’un de nous é tait trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c’é tait le drame. L’Abuela et Papi é taient toute notre vie. Toute la mienne surtout. Je me sentais à l’abri auprè s d’eux lorsque j’é tais enfant. J’espè re qu’à mon tour j’ai ré ussi à leur procurer cette sensation quand les anné es les ont fragilisé s.
L’Abuela a é té le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de bé ton au café de Marseillette n’é tait pas un cadeau à nous faire. L’Abuela de toute fa§on, si elle a dé cidé que quelque chose est bon pour toi, tu n’as aucune marge de manœ uvre. Autant se faire une raison.
Je reluque la commode du coin de l’œ il. J’aper§ois une enveloppe au fond du tiroir rose, je reconnais l’é criture appliqué e de ma grand-mè re. Et s’il y en avait d’autres? Je commence à comprendre…
Il va falloir y aller maintenant: attaquer par le premier tiroir, quitte à ne plus lâ cher jusqu’au petit matin. J’ai retourné le vinyle de Morricone. Je me suis assise devant la commode aux tiroirs de couleurs.
À nous deux maintenant Abuela. Surprends-moi. Encore.
1.
La mé daille de baptê me
Je te confie ma mé daille de baptê me, cariñ o, elle a é té mon seul compagnon « de valeur » du voyage. Depuis toujours, on me disait d’y faire attention comme à la prunelle de mes yeux, alors je me sentais riche de la possé der. J’imaginais qu’en la vendant je pourrais me sortir de toutes les situations.
J’ai é té baptisé e tard pour l’é poque. Mes parents et leur aga§ante modernité ! Ils attendaient que je sois capable de choisir mon Dieu. Heureusement que mes grands-parents s’en sont mê lé s, car moi je voulais juste ê tre comme les autres, comme les miens, reconnue et proté gé e par ce Dieu-là, le leur, le mê me. J’ai vé cu ce moment avec un sé rieux, que dis-je, une solennité qui a beaucoup é mu ma mè re et fait beaucoup rire mon pè re. Je portais une jolie robe de soie blanche. Ma famille possé dait quelques champs de mû riers où elle é levait des vers à soie, alors les tisseurs nous arrangeaient pour les grandes occasions. Un jour mon grand-pè re a ravagé l’un de ses champs en se fabriquant des ailes avec les branches de ses mû riers. Nous avons tous é té convié s à l’envol… droit vers le sol! Il ne fit aucune expé rience des cieux, juste celle d’une terrible douleur à la hanche droite qu’il garda toute sa vie. Mais enfin §a, mi cielo, c’est une autre histoire.
Regarde, ma mé daille est à l’effigie de saint Christophe, le patron des voyageurs. C’est drô le, car l’exil é tait mon premier pas hors d’Espagne, et la France ma derniè re destination, tu parles d’une globe-trotteuse! La semaine qui a pré cé dé notre dé part, ma mè re a cousu une minuscule poche à l’inté rieur de chacune de nos culottes. « Toi, Rita, tu dormiras avec ta mé daille autour du cou ou autour de ton poignet, et tous les matins, tu la rangeras dans la poche de ta culotte du jour. Elle sera toujours avec toi et personne ne pourra te la voler. Tu la porteras à nouveau sans crainte dè s que les ré publicains auront gagné. » Sans crainte de quoi? Je n’ai pas eu le temps de poser la question. Maman savait bien que je n’avais jamais eu peur de rien. Je tenais §a de mes parents d’ailleurs. Et monter dans un train pour la France, ce n’é tait pas plus insensé que se faufiler dans les bois à la nuit tombé e pour que les adultes organisent la ré sistance. Pendant ce temps, au lieu de jouer aux cow-boys et aux Indiens, nous, les enfants, on jouait aux franquistes et aux ré publicains. Tous voulaient ê tre communiste, anarchiste ou socialiste, parce qu’ils gagnaient toujours à la fin. Oui, les ré publicains, c’é taient ceux-là, tous les courants de la gauche ré unis contre Franco, dans une entente toute relative vers un mê me dessein.
Mes parents s’aimaient autant qu’ils aimaient leur parti et leur patrie. Ils en revendiquaient la langue, l’art de vivre, les coutumes, mais aussi la combativité, la radicalité frô lant la folie, et le courage. Personne n’aurait pu les en dé possé der. Ma mè re ré pé tait à l’envi qu’on est maî tre de son destin. Elle cuisinait ce leitmotiv à toutes les sauces. Cette phrase pouvait clore une discussion agité e, laissant l’auditoire pantois, comme ré veiller l’ambiance d’une tablé e en manque de sujet de conversation. Il faut dire qu’elle y mettait toujours le ton à son fameux: « On est maî tre de son destin », et grâ ce à §a on se sentait invincibles mes sœ urs et moi.
Depuis plusieurs semaines, l’invulné rabilité du clan semblait é branlé e. Papa et Maman ne faisaient plus un pas dehors sans se retourner. Nous avons dé mé nagé chez Angelita et Jaime, de vieux amis, à Barcelone. Mes parents ne travaillaient plus, ne sortaient presque plus, mais passaient tout leur temps à é crire et à organiser des ré unions. Plusieurs fois par jour, des gosses des rues dé posaient des documents et en ré cupé raient d’autres contre une piè ce ou deux. Mes sœ urs et moi, nous n’é tions plus scolarisé es. Certains enfants avaient é té enlevé s et envoyé s dans le quartier de la honte à Alicante, dans des camps d’endoctrinement où on
broyait leur cerveau pour en reconstruire un qui serait voué à servir le
« guide ». Plutô t mourir!
Un soir, tandis que nous rentrions du dé filé del Dí a de los Reyes les poches bourré es de bonbons, Papa a allumé la radio aprè s avoir poussé la porte de la maison, comme à son habitude. La voix dans le poste a parlé d’un projet, d’un massacre, de sang, de Barcelone, et Papa a dit qu’il é tait temps de nous mettre à l’abri. Selon lui, nous avions moins de trois semaines pour agir. Il ne fallait pas nous inquié ter, nous rentrerions dè s que Papa et Maman auraient fait tomber le ré gime de Franco. Nous partions pour la France, nous ne serions pas loin, et là -bas il n’y avait ni bombardement ni dictateur, nous serions bien. Angelita et Jaime seraient avec nous tout le voyage, et nous amè neraient jusque chez le tí o Pepe qui vivait depuis vingt ans dans la ville de Narbonne, prè s de la mer. Nous n’avions jamais entendu parler du tí o Pepe ni de Narbonne. Jamais entendu parler de la France ni entendu parler fran§ais. Jamais quitté notre pays. Et tous ces jamais ne m’effrayaient pas tant mes parents, mê me dans l’urgence, avaient pris soin d’embellir le scé nario qui nous attendait. Mieux vaut croire au Pè re Noë l et souffrir d’apprendre son inexistence que de ne pas goû ter au plaisir de la rê verie infinie qu’il engendre, non? Là, c’é tait un peu la mê me chose. Un mensonge aimant, protecteur, pour que nous puissions tenir au moins jusqu’à l’arrivé e à Narbonne.
Les mines dé faites de mes parents auraient dû nous mettre la puce à l’oreille sur le quai de la gare. Leurs tê tes é taient mises à prix dans tout le pays et au-delà. Condamné s, ils avaient dé cidé de mettre fin à leurs jours ensemble. Dieu seul sait si d’autres ont connu un tel amour.
Avec mes sœ urs, on s’est dé brouillé es comme on a pu. Ta grand-tante Leonor é tant la plus â gé e, c’est elle qui a dé cadenassé la valise et trouvé la lettre de Papa et Maman en arrivant à Narbonne. À sa lecture ont jailli au visage de Leonor des torrents de souvenirs qui prenaient tout leur sens. Je n’oublierai jamais son regard. J’ai pu y lire tour à tour la rage de ma mè re et l’impé né trabilité de mon pè re. Elle a gardé le secret jusqu’à ce que Carmen soit en â ge de comprendre. Enfin, jusqu’à ce qu’elle juge que Carmen et moi soyons en â ge de comprendre. C’est maintenant, en te le racontant, que je mesure à quel point ma sœ ur a é té solide. Elle é tait si dure avec nous, et moi si enfermé e dans ma fureur adolescente, que je lui en ai voulu souvent, et c’é tait injuste. Leonor avait six ans de plus que
moi, Carmen quatre de moins. Moi, j’avais dix ans. Oui, c’est §a, nous avions six, dix et seize ans le jour où nous avons embrassé nos parents pour la derniè re fois.
Le train n’est pas allé jusqu’à Narbonne. Nous avons é té dé barqué es à Gé rone et nous avons dû finir à pied. Il fallait laisser nos siè ges aux milices qui partaient en rafle dans les villages frontaliers. Les ré publicains actifs qui essayaient de quitter le territoire é taient traqué s, monnayé s, puis faits prisonniers. Et quand il fallait faire de la place dans les geô les…
Je ne comprenais pas tout §a à l’é poque. Dè s que Leonor percevait l’inquié tude de Carmen et la mienne, elle nous rappelait que tout cela é tait provisoire et que les mé chants franquistes seraient bientô t repoussé s par les gentils ré publicains. Et comme ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin… Hop, é quation ré solue, « tranquilo nenas, bonne nuit.
— Bon, ben si c’est bientô t fini, alors… Bonne nuit. » C’est si facile de partir quand on ignore que c’est peut-ê tre pour toujours.
Quelle sensation de liberté au dé part! Quelle euphorie pour Carmen et moi! Le soleil donnait des allures estivales à ce mois de fé vrier. Nous partions à la dé couverte d’un nouveau monde, et des centaines d’enfants de notre â ge couraient à travers les Pyré né es avec nous. Pour Leonor, c’é tait diffé rent, bien sû r. Elle é tait concentré e, elle savait ce qui nous attendait, ou le pré sageait. Les autres aussi. Le contraste entre les explications de mes parents et les visages fardé s d’inquié tude qui composaient le cortè ge commen§ait d’ailleurs à me poser question.
À mi-chemin, l’excitation é tait largement redescendue pour Carmen et moi. Le froid se faisait plus pré sent, la fatigue pesante, et certains souliers n’avaient plus de semelles. Le râ le de la procession, bourdonnement composé de pleurs de bé bé s et de plaintes contenues, retentissait en é chos sur tous les versants de la montagne.
Au Boulou, on sé para les hommes des femmes et enfants. Le dé part de Jaime fut terrible. Angelita portait leur enfant et hurlait sa dé tresse. Nous la serrions de toutes nos forces pour essayer de la calmer, en vain. Carmen pleurait aussi, sans trop savoir pourquoi. Autour de nous, les familles é taient dé chiré es, se disloquaient en larmes, oubliant la morsure du vent tant celle des cœ urs é tait violente.
Nous avons tous eu droit à une tourné e de piqû res à la frontiè re. Personne n’a demandé de quoi il s’agissait, trop anesthé sié s dé sormais par le froid et la faim. Nous n’avons jamais su. Mes sœ urs et moi é tions loin d’ê tre les plus mal loties, Maman avait pris soin de mettre de grosses laines dans notre valise, et une paire de chaussures neuves pour chacune d’entre nous. Mais l’appré hension à l’approche de l’inconnu grandissait en nous, surtout maintenant que le seul homme du groupe n’é tait plus là. Puisque nous rentrerions tous bientô t, pourquoi tant de peur et de tristesse s’emparaient de notre troupe? Je devrais parler de troupeau tant les autorité s, fran§aises comme espagnoles, nous traitaient comme du bé tail.
À deux reprises sur les cent cinquante kilomè tres parcourus, des convois de la Croix-Rouge nous ont apporté de l’eau et quelques vivres. Au Boulou, une mamie donna une petite boî te de mantecados et de dedos de bruja à Carmen. Ils ressemblaient é trangement à ceux de l’Abuela, la mienne, partie quelques mois plus tô t d’un cancer de l’estomac. Chaque fois qu’on demandait à ma mè re de quoi l’Abuela s’é tait é teinte, elle ré pondait avec une colè re contenue: « Ma mè re n’a pas digé ré que son peuple laisse une ordure prendre possession de sa terre. » C’est tout.
Cette parade en effrayait plus d’un, car personne ne soup§onnait que l’on puisse mourir de §a. C’é taient ses convictions qui l’avaient tué e, notre vieille, pas quelque chose qui gagne encore et encore du terrain puis gagne tout court malgré le combat, comme ce malparido de Caudillo.
L’é clat de la boî te de biscuits se reflé tait dans les yeux ré jouis de ma petite sœ ur. C’é tait doux à voir au milieu de ce dé sastre. J’é changeai avec Leonor un sourire complice. Le premier et le dernier du pé riple. Elle ne voulait pas que je per§oive sa peur, je ne voulais pas me soumettre à son autorité. Aprè s tout, elle n’é tait pas ma mè re. Carmen refusa dans un premier temps de partager. C’é tait son cadeau. Et faim ou pas faim, il ne fallait pas y compter. Elle-mê me ne goû ta pas tout de suite son tré sor, malgré son petit ventre qui criait famine. Nous é tions parties depuis deux jours, alors les bocadillos de Maman é taient loin, et les biscuits de la Croix-Rouge aussi.
Mais en cent cinquante kilomè tres nous avions grandi de plusieurs anné es, et Carmen vint d’elle-mê me distribuer é quitablement son butin.
Leonor et moi avons insisté pour qu’elle en garde un peu plus pour elle, pré textant qu’elle é tait en pleine croissance, comme le disait Maman, et que de toute fa§on nous n’avions pas faim. Elle s’y opposa. Deux mois plus tô t, j’aurais é crabouillé sans vergogne la main de ma petite sœ ur pour les lui piquer, et elle aurait fait preuve d’une incroyable inventivité pour les mettre à l’abri de ma gourmandise. Mais là, é videmment…
Nous é tions une centaine dans notre é quipé e, pourtant devant nous, une maré e humaine avan§ait, telles des milliers de fourmis, courageuses et vulné rables, handicapé es par le froid glacial et le poids des bagages, mais d’une volonté sans pareille.
Nous sommes arrivé es de nuit au camp d’Argelè s. Un froid de connard, cette nuit-là ! Ah non pardon, de canard… Je ne voyais pas trop ce qui pouvait valoir la dé nomination de camp à cet immense enclos sur la plage, dé limité par des barbelé s. Je crois que j’imaginais un camping gé ant depuis qu’à Cerbè re le nom de camp avait é té prononcé. Mais cette vaste é tendue de sable ressemblait plutô t à un mouroir: une cinquantaine de cahutes é parses, aussi brinquebalantes que la maison de paille du fainé ant petit cochon, puis quelques braseros et des fantô mes agglutiné s autour. Presque rien. Juste des corps laminé s par le vent et les crampes d’estomac, des â mes lamenté es par les souvenirs et le renoncement.
Quatre infirmiè res nous ont rejoints avec des tas de baluchons en toile de jute sur les bras. Elles é taient douces et enveloppantes, disponibles malgré l’afflux massif. Que c’é tait chaud, cette bonté gratuite, aprè s tout un chemin à ê tre traité s comme des vaincus! Peut-ê tre que la vocation de Leonor s’est forgé e à ce moment-là. Chaque famille a re§u deux couvertures, un pain et un petit jerrican d’eau quasiment gelé e. Elles nous ont installé es dans un baraquement où gisaient dé jà une bonne trentaine d’occupants à bout de forces, comme nous. Elles é taient gentilles, ces Fran§aises. Nous le sentions, mê me sans comprendre un mot de ce qu’elles nous disaient. Nous avons fait notre « nid » prè s d’une femme enceinte encore plus grosse qu’Angelita. Elles se sont allongé es l’une contre l’autre, et moi contre Angelita pour caresser son ventre et rassurer le petit. On aurait dit deux œ ufs de dinosaures pondus sur un nid de chiffons. Leonor a coupé le pain en quatre et personne n’a pensé à faire des ré serves au cas où. Carmen s’est endormie en mangeant le sien. Un
toit, mê me prê t à s’envoler, mê me avec les odeurs de cette masse salie par son voyage, §a l’avait rassuré e, la petite.
J’ai rê vé toute la nuit de la fideuá de Maman. Je pouvais sentir el socarrat sous ma dent. Tu sais, c’est la partie grillé e du riz pour la paella et des pâ tes pour la fideuá , qui colle au fond du poê lon. C’est le meilleur. Croustillant et gorgé de sucs. Je l’avais tant ré primé e à l’é tat d’é veil que la faim s’é tait invité e dans mon sommeil. Le ré veil n’en fut que plus dur.
Mes yeux s’ouvrirent dè s les premiers rayons du soleil. Chez nous, on le gardait bien enfermé dehors, le soleil, brute é touffante que nous fuyions pour hiberner aux heures où sa violence devenait l’ennemi de nos peaux. Pour une fois qu’il pouvait ê tre protecteur au lieu d’ê tre celui dont on se protè ge, pour une fois qu’il pouvait dé fier ce froid qui nous rapetissait pour lui imposer sa toute brû lante puissance… ¡ Coñ o! Quel lâ cheur!
Je remarquai soudain la petitesse de Carmen. Soixante-douze heures avaient suffi à donner une allure maladive à sa silhouette dé jà frê le. Ma petite sœ ur avait à peine six ans, et un hamac obscur se dessinait sous chacun de ses yeux. Elle avait des cernes! C’é tait inacceptable. Je continuai à parcourir la piè ce du regard, dé couvrant des visages é macié s maladroitement posé s sur des corps dé charné s. Depuis quand é taient-ils là ? Combien de chemin parcouru pour arriver ici? Et pour quoi? É tait- ce vraiment ê tre à l’abri que de se retrouver loin des siens et de sa terre sur un tapis de sable gelé ?
Je sentais ma colè re monter. Mon courroux enflait contre mes parents, contre Leonor, contre je ne savais quoi, mais une boule de haine grossissait à vue d’œ il dans mon ventre. Je crois que c’est à ce moment- là que j’ai compris que non, ce n’é tait pas rien, non, ce n’é tait pas temporaire. Non. J’ai compris que toute ma vie serait é crite à l’encre rouge de ces quelques jours.
La Croix-Rouge a appelé le tí o Pepe. Pour sortir du camp, il fallait qu’un ré sident fran§ais confirme qu’il pouvait accueillir le ou les ré fugié s concerné s. Il s’y est engagé et nous avons pris un train pour Narbonne. Je regrette aujourd’hui. J’aurais dû rester. Quand nous avons quitté le camp, j’ai eu la sensation d’abandonner tous ceux qui en é taient prisonniers. Si j’é tais resté e, j’aurais pu aider, participer, soigner. J’avais choisi de suivre les directives de Papa et Maman, de sauver ma peau, de me soumettre. La
honte m’a habité e tout le voyage, venant chasser la joie qui se glissait dans mon cœ ur à l’idé e de retrouver un vrai toit. Cette dé sagré able sensation, cette culpabilité, me visite encore en rê ve parfois, et me hante toute la journé e suivante.
Angelita resta dans le camp d’Argelè s. Elle espé rait y retrouver Jaime avant de partir, car des charrettes venaient le lendemain ré cupé rer les futures mamans et les amener à Elne pour enfanter. Nous ne voulions pas la quitter. Qui allait prendre soin d’elle? Une infirmiè re franco-espagnole nous expliqua qu’à Elne, Angelita serait mieux que nulle part ailleurs. Une dame, une Suisse, é tait en train d’y mettre en place un lieu où les femmes et les enfants seraient proté gé s. Une maternité, oui, mais bien plus encore. Un havre de paix. Elle racontait bien, cette infirmiè re. Ou alors c’est juste que, pour une fois, on nous disait la vé rité, et nous le ressentions. Elle nous apaisa avec son histoire, et les au revoir en furent moins pé nibles. Leonor confia le numé ro du tí o Pepe à Angelita. Parce que, comme disait ma mè re, on ne sait jamais. Qu’est-ce qu’elle avait raison, ma mè re…
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|